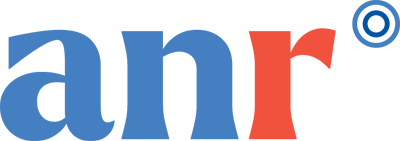Le mardi 8 avril 2025, les porteurs d’actions et partenaires du DemoES INCLUDE se sont réunis pour leur séminaire annuel. Un rendez-vous pas tout à fait comme les autres, puisqu’il marquait le dernier séminaire du projet, à l’approche de la fin de ces quatre années de financement dans le cadre du programme France 2030.
Un séminaire particulier également par son lieu d’accueil. En effet, à occasion exceptionnelle, lieu exceptionnel. Les équipes INCLUDE furent accueillies au sein des locaux de l’un de ses partenaires, le SDMIS (Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours), à l’École départementale des sapeurs-pompiers, située à Saint-Priest, en périphérie lyonnaise.
Ce temps fort a permis de dresser un premier bilan d’INCLUDE et de poursuivre les travaux collaboratifs engagés dans le cadre du projet dans un environnement hors du commun, propice à l’inspiration et à l’échange.

Ouvert par le Lieutenant-colonel Christian Bouché, Adjoint au directeur des ressources humaines du Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours et Directeur de l’école départementale-métropolitaine des sapeurs-pompiers du Rhône, le séminaire a également été l’occasion d’une prise de parole de la nouvelle Vice-Présidente déléguée à l’Inclusion de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Nathalie Guin, également pilote d’action INCLUDE.
Une visite immersive au cœur de la formation des secours du SDMIS (GFOR)
Moment marquant de la journée : la visite guidée du centre de formation du SDMIS par le Lt Colonel Christian Bouché, son adjoint le commandant Kerian Adarouch, la Commandante Amelie Genin, le capitaine Mohamed Maamir également Chef du Pôle Simulations, le Lieutenant Fabrice Reybard, Sébastien Beauvoir, l’adjudant-chef Yannick Daloux concepteur de formation et le Chef du bureau du numérique (GFOR) Gauthier Gineyt.
Les participants ont pu découvrir les infrastructures de l’établissement, alliant formation technique et conditions immersives, visant à former tous les sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon.





Au programme de la visite :
- la tour d’entraînement, reproduisant des situations d’intervention en hauteur,
- la maison à feu, bâtiment dédié aux simulations d’incendie en conditions réelles (fumée, chaleur, obscurité),
- les zones de secours routier : espace pour s’exercer à l’extraction de victimes dans des véhicules accidentés (notamment à l’aide de tablettes numériques guidant les interventions en fonction de la typologie des véhicules)
- les espaces pour l’entraînement en milieu confiné ou souterrain
- ainsi que les plateformes numériques pour la simulation, l’analyse de gestes et la formation à distance, un véritable hub d’innovation pédagogique au service de la sécurité civile.
Ainsi, le numérique apparait alors comme une aide à la formation, au perfectionnement, à la prise de décision éclairée, et au gain d’efficacité sur le terrain.
Cette immersion a offert aux participants un aperçu concret de la rigueur et de la technicité des sapeurs-pompiers au quotidien. Elle a également permis de nourrir les réflexions autour des thématiques clés et communes d’INCLUDE : inclusion, innovation, transmission et coopération.
Des activités conviviales pour préparer la communication web des actions INCLUDE et rendre compte du chemin parcouru…

L’après-midi a été consacré à deux activités durant lesquelles les participants étaient regroupés par action.
La première activité a consisté à préparer des gabarits de pages web des actions et des différents livrables.
La seconde, plus ludique, a invité les contributeurs à retracer le parcours et la trajectoire de leur action. Sous la forme symbolique d’une route, il s’agissait d’inscrire, de dessiner ou encore de coller différents éléments matérialisant les grandes étapes des 4 années de développement de leur action : les réussites, échecs, les évolutions passées et leur vision de l’avenir.

Pour finir, INCLUDE : un premier bilan
Le séminaire a également été l’occasion de dresser un premier bilan du projet et tirer quelques conclusions.
Philippes Malbos, Directeur scientifique d’INCLUDE, a d’abord présenté quelques actions concrètes qu’a permis de développer le projet pour favoriser l’inclusion dans l’enseignement supérieur :
- Techno-pédagogies :
→ Utilisation de la plateforme Jupyter pour créer et partager des activités interactives.
→ Création de salles hyperconnectées favorisant un enseignement à distance inclusif (Salles Include 1 :1). - Transformation des cursus :
→ Introduction de technologies immersives pour enrichir l’expérience pédagogique et réinventer les formats de cours. - Formation des enseignants :
→ Mise en place de plans de formation à l’enseignement inclusif.
→ Organisation d’ateliers d’intelligence collective pour renforcer les compétences pédagogiques. - Environnement pédagogique inclusif :
→ Déploiement de salles virtuelles accessibles à tous.
→ Parcours immersifs XR pour développer les compétences pratiques. - Certification des compétences :
→ Utilisation de Tomuss+, un outil de suivi et de visualisation des compétences des apprenants.

Un 1er bilan de quatre années d’expérimentations : freins et blocages persistants
Puis Philippe Malbos a exposé quelques conclusions.
Aujourd’hui, en effet, à travers le développement des différents travaux d’INCLUDE, des constats émergent et des réalités doivent être prises en compte, comme le souligne en conclusion le Directeur du projet.
« Nous avons identifié des freins sur plusieurs volets. » : des réponses encore insuffisantes aux situations de handicap, une autocensure territoriale persistante, et une difficulté à adapter les formats pédagogiques aux nouveaux profils étudiants.
En matière d’accessibilité, « on arrive difficilement à répondre à l’ensemble des besoins », que ce soit en lien avec le handicap ou avec « les problématiques de campus, de territoire et de géographie », qui se heurtent à « trop de blocages, parfois idéologiques. »
Un manque d’engagement collectif est soulevé avec « une adhésion pas assez massive des composantes de formation et des équipes pédagogiques. »
Également, le système éducatif semble peiner à s’adapter à l’évolution du profil « des étudiants plus connectés, multitâches, collaborateurs, participatifs, visuels… »
« Nous nous heurtons encore à la rigidité de nos cadres de formation. » Cette rigidité se manifeste sur plusieurs plans : temporel « Temporalisé, séquencé, parallélisé, minuté », spatial « Hyper-localisé […] pas assez au sein des territoires », organisationnel « Pas assez tout au long de la vie […] « où l’on bute encore trop sur la réussite, la passerelle, la personnalisation des cursus. »
Même les organisations rencontrent des freins : « Les techno-pédagogies inclusives percolent trop lentement » et « les aménagements adaptés […] ne peuvent plus l’être avec plusieurs dizaines de milliers d’étudiants. » Le défi est important pour un corps académique tiraillé entre deux missions fondamentales : « être en première ligne sur le front de la création des connaissances […] et de la transmission […] tout en développant une pédagogie inclusive. »
La désaffection des étudiants en amphithéâtre questionne en profondeur le rôle de cet espace emblématique. « On peut s’interroger sur la fonction sociologique de l’amphithéâtre de l’université dans la société française de 2025. »
Ces constats poussent à imaginer autrement les espaces-temps pédagogiques. « Il s’agit peut-être de faire émerger une autre façon d’habiter le temps et l’espace pédagogique. »
Philippe Malbos rappelle qu’INCLUDE est animé par un objectif fondamental : « Faire évoluer notre projet pédagogique global, rendre nos organisations plus apprenantes, et ainsi apporter une contribution académique puissante à la reconstruction d’une société plus inclusive. »
Lancé en 2021, dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire et institutionnelle, le démonstrateur INCLUDE a su réunir « Un consortium très large de 4 universités, 3 écoles, représentant 120 000 apprenants » et « ce sont plus de 60 collaborateurs qui ont donné vie à ce projet. »
Face à ces collaborations vertueuses, Philippe Malbos invite, pour conclure, à prolonger cette dynamique collaborative :
« J’espère que l’esprit d’Include pourra se poursuivre dans une nouvelle forme de coordination à l’échelle de notre site. » « J’espère que l’esprit d’Include pourra se poursuivre dans une nouvelle forme de coordination à l’échelle de notre site. »
En d’autres termes, le projet INCLUDE constitue une première brique, qui aura permis, outre la création d’un panier de solutions concrètes d’accessibilité dans l’ESR, d’ouvrir de nouveaux territoires de recherche et d’expérimentation pour répondre à ces nouveaux enjeux.
Un grand merci aux équipes du SDMIS
L’équipe INCLUDE tient à adresser ses plus sincères remerciements aux sapeurs-pompiers et aux équipes pédagogiques du SDMIS pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité, la richesse des échanges et la transmission avec passion. Leur engagement quotidien pour la sécurité de tous, le développement d’innovations et de solutions efficientes pour un apprentissage par compétences en adéquation constante avec les évolutions des besoins, force le respect et a profondément marqué l’ensembles des participants.
Ce séminaire restera un moment fort du projet Include, à la croisée des mondes de l’apprentissage, du service public et de l’innovation collective.